n°301 l'Intelligence Artificielle Septembre - Octobre 2025*
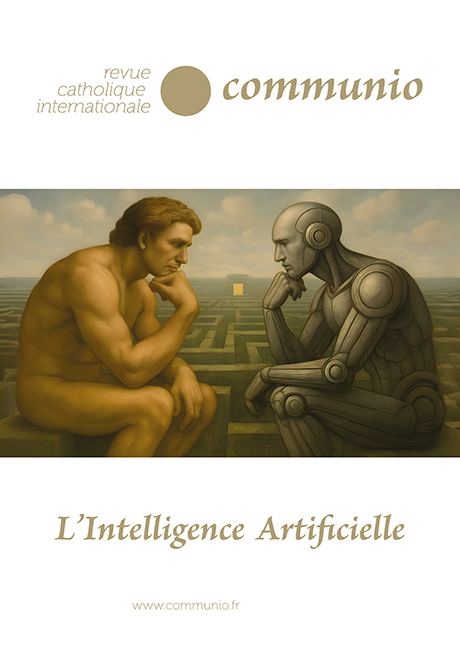
Parfois plus rapide et plus performante que l’homme, l’intelligence artificielle est à l’origine d’une révolution technologique qui suscite la peur ou la fascination. La machine ne risque-t-elle pas de surpasser l’intelligence humaine qui l’a créée ? Résister à l’idolâtrie comme à la techno-phobie permet de situer l’intelligence arti ficielle à sa juste place, de repérer ses vertus et ses limites – mais aussi de mieux saisir ce qui fait le propre de l’intelligence humaine
Éditorial : Jean-David Fermanian, Isabelle Rak :
Mettre l’Intelligence Artificielle à sa juste place.
Jean-David Fermanian, Isabelle Rak Démystifier l’Intelligence Artificielle
L’intelligence artificielle (IA), dans ses récents développements, semble surpasser les capacités cognitives et même créatives de l’être humain. Or l’IA n’est qu’un outil extrêmement puissant de traitement statistique d’informations à partir des données disponibles sur Internet. Sans nier ses nombreux avantages, il faut relativiser non seulement ses capacités de développement mais aussi ses prétentions à rivaliser avec notre intelligence : elle nous invite en revanche à penser ce qui fait le propre de l’intelligence humaine.
Noreen Herzfeld : Rester pleinement humain à l’heure de l’IA − Entretien avec Tibor Görföl
Malgré la fascination qu’exerce l’IA, au point de devenir une sorte de religion pour certains transhumanistes, son avenir reste limité en raison du caractère indéfectiblement incarné de l’être humain. Privé de libre arbitre, d’émotions, de conscience, cet outil ne peut être intelligent. En confiant à des algorithmes la prise en charge des personnes, nous ne risquons pas seulement de perdre certaines de nos compétences : le risque est celui d’une « déqualification » morale, voire spirituelle.
Jacques Henno : Les étapes du développement de l’Intelligence Artificielle
L’intelligence artificielle est née au milieu du XXe siècle, en lien avec les premiers développements de l’informatique. Les espoirs nés de la cybernétique et des systèmes experts ont été depuis largement dépassés par l’émergence des réseaux de neurones et de l’IA générative. Ces derniers ont ouvert la voie à une omniprésence de l’IA dans notre environnement.
Thomas Souverain : L’IA générative, nouvelle idole ?
Telle que la connaît le grand public, l’IA générative parle en première personne et semble omnisciente. Certes, rares sont ceux qui l’assimilent à un oracle ou lui vouent un culte religieux. On peut néanmoins se demander si l’idolâtrie ne domine pas certaines de nos représentations de l’IA, lorsque nous célébrons nos prouesses techniques, au point de confondre la vérité et ses simulacres.
Groupe de Travail Intelligence Artificielle du Centre Teilhard de Chardin : La mécanisation de la pensée ou la triple réduction
Une conception matérialiste largement répandue mécanise la raison, en l’assimilant à des capacités de calcul. Cette conception erronée s’appuie sur un triple réductionnisme, aux plans cognitif, neuroscientifique et informatique. Du point de vue de la science comme de la tradition biblique, la pensée humaine reste l’acte exclusif d’un être vivant.
Laure Solignac : Irréductible intelligence − Les leçons du Moyen-Âge
La pensée médiévale établit une nette distinction entre l’intelligence et la raison, deux notions qui tendent aujourd’hui à se confondre. Le détour par le Moyen-Âge nous permet de comprendre pourquoi l’intelligence ne se réduit pas aux fonctions qu’un ordinateur assure de nos jours avec une efficacité bien supérieure à la nôtre. Il nous rappelle qu’elle est avant tout capacité d’étonnement et d’admiration.
Cardinal Josef Ratzinger : La technique nous protège-t-elle ? Une question éthique et sociale
Pensée et développée pour protéger l’homme face aux menaces des forces naturelles, la technique a généré en retour de nouvelles menaces, non seulement envers l’environnement, mais aussi et surtout à l’encontre de la liberté et de la responsabilité humaines. Écrit en 1982, quarante ans avant l’apparition de ChatGPT, cet article montre de manière pro- phétique l’urgence d’une intégration de la « raison éthique » dans la « raison technique », pour que la domination de l’homme sur le monde le conduise, non à posséder plus, mais à être plus.
Mettre l'Intelligence Artificielle à sa juste place
Les deux dernières décennies ont vu l’émergence de nombreux outils innovants basés sur les développements récents de l’intelligence artificielle (IA), au niveau de la science des données comme de l’ingénierie. Dans bien des domaines, ils semblent représenter les prémisses d’une révolution technologique majeure, qui a déjà commencé. Les uns, admiratifs devant leurs prouesses techniques, acclament ces avancées : logiciels conversationnels aux savoirs encyclopédiques et qui semblent même pouvoir devenir d’authentiques interlocuteurs, voitures autonomes qui nous transportent sans effort, robots qui nous assistent dans nos tâches quotidiennes, etc. Les autres s’inquiètent des conséquences d’un déploiement massif de ces nouveaux outils, synonymes de rupture sociétale voire anthropologique. Le rêve d’une « intelligence artificielle générale », capable de toutes les tâches intellectuelles qu’un être humain peut effectuer, paraît à portée de main. La place de l’homme dans la société et dans la Création est déjà remise en question par l’émergence de machines qui semblent plus performantes que lui dans bien des domaines. Ces questionnements dépassent le champ strict de la réflexion sur les nouvelles technologies, comme les récentes déclarations du Saint Siège 1 l’attestent.
La nature et les apports de l’IA
On ne peut nier que, comme la plupart des révolutions scientifiques et techniques, les machines, logiciels, algorithmes, basés sur l’IA portent en eux des promesses de progrès effectifs pour les hommes dans leur vie quotidienne, au travail, dans la société. En effet ils peuvent libérer l’homme de tâches considérées comme pénibles, voire aliénantes 2, lui permettre un accès immédiat, synthétique et compréhensible à la connaissance « numérisée » de l’humanité disponible sur internet, améliorer la performance des diagnostics médicaux, réaliser des actes chirurgicaux de haute précision, etc. La « productivité » de l’être humain se trouve globalement accrue, et souvent son bien-être. En effet, la possibilité de générer de nouveaux textes, images, musiques, et bientôt vidéos apparaît comme une source d’enrichissement pour notre culture et nos loisirs. Sous cet angle, l’IA pourrait alors être vue comme une étape de plus du développement des sociétés industrielles : il y eut la machine à vapeur, puis le moteur à essence, la pétrochimie, l’ordinateur, et maintenant le robot et le réseau de neurones. Le fonctionnement de ces dernières innovations semble « intelligent » car leurs capacités sont apparemment proches, voire supérieures à celles des hommes. Dans son panorama historique des développements de l’IA, Jacques Henno 3 montre que le cœur de ces machines qu’on pourrait qualifier « d’intelligentes » est constitué d’algorithmes et de programmes informatiques extrêmement complexes. Leur conception et leur déploiement à grande échelle ont été rendus possibles par l’avènement d’internet, par des capacités de stockage et d’exploitation de données de tailles gigantesques, et des puissances de calcul sur ordinateur (ou cartes graphiques) qui ont considérablement augmenté.
Les avancées technologiques apportées par l’IA n’ont donc rien de magique. Pour faire bref, on pourrait qualifier un outil d’IA de « logiciel sophistiqué implanté dans une machine, et qui interagit avec l’utilisateur ». En quoi ce paradigme serait-il fondamentalement de nature différente, voire inquiétante, au regard de l’histoire du développement de nos sociétés industrielles post-modernes ? Le trouble provient du fait que l’utilisateur d’IA est en général humain, et qu’il ressent un malaise devant « sa » machine : cette dernière réalise en effet des tâches, fournit des réponses, des préconisations, qui jusqu’à présent étaient réservées aux hommes. Et bien souvent, elle le fait avec plus d’efficacité et de pertinence que la plupart des êtres humains. Ce qui distingue l’homme des animaux dans la Création, son intelligence, son « génie » pratique mais aussi conceptuel, et peut-être même son imagination et sa créativité seraient-ils désormais partagés par une machine ? Le réalisme des IA conversationnels pourrait nous amener à considérer que l’utilisateur d’une IA est en relation avec une entité réellement intelligente. Heureusement, il n’en est rien
Une intelligence qui n’en est pas une
Qualifier une machine d’« intelligente » provient d’une conception mécanique de la pensée. Comme le groupe de travail sur l’IA du Centre Teilhard de Chardin 4 nous l’explique, cette conception repose sur un réductionnisme épistémologique, qui peut être identifié à différents niveaux d’analyse : (i) au plan cognitif, la réduction de la pensée au traitement de l’information ; (ii) au plan neuroscientifique, la réduction de la cognition au calcul neuronal ; (iii) au plan informatique, la réduction des réseaux de neurones biologiques à des réseaux artificiels.
Les réflexions sur l’IA offrent ainsi une occasion salutaire de saisir ce qui fait le propre de l’intelligence humaine. Nous sommes en effet souvent plus proches de la machine que nous ne saurions l’admettre : une multitude d’automatismes régissent notre langage ou même nos prises de décision – généralement à notre insu ; là où nous croyons penser ou créer, nous nous contentons souvent de « compiler » avec plus ou moins de bonheur. Mais seuls ceux qui réduisent l’intelligence humaine à ces mécanismes peuvent craindre que l’IA n’entre en concurrence avec celle-ci.
Pour échapper à ces visions réductrices, un détour par les concepts légués par les Anciens s’avère indispensable. Laure Solignac nous rappelle avec bonheur la distinction traditionnelle au Moyen-Âge entre raison (ratio) et intelligence (intelligentia ou intellectus) 5. Alors que la première concerne les capacités d’analyse, de synthèse, de résolution de problèmes, la seconde est plus intuitive, plus englobante, moins dépendante des sens. Trait d’union entre le visible et l’invisible, l’intelligence nous permet d’accéder à des réalités qui dépassent la sphère humaine stricto sensu. Cette capacité de notre âme humaine reste et restera inaccessible à toute machine, même avec le qualificatif d’IA. L’idée de Dieu et, a fortiori, d’une divinité avec qui nous pouvons entrer en relation constitue une limite infranchissable à des assemblages de puces de silicium, même « entraînées ».
Les limites d’une technique
Bien qu’elle n’ait rien de magique, l’IA provoque ce mélange d’attrait irrésistible et de paralysie morale qui caractérise toute fascination. Il faut dire que ses outils ne sont pas des objets/outils/machines/ algorithmes comme les autres. Beaucoup d’entre eux sont intrusifs par vocation et par construction. En particulier, les IA génératives et conversationnelles prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, via nos smartphones, ordinateurs, etc., au point d’en devenir des pseudo-compagnons de route, voire des substituts affectifs. Ainsi, dans le film Her 6, le héros tombe amoureux d’une entité artificielle avec laquelle il communique via un ordinateur. Thomas Souverain souligne le risque de transformer certaines IA en idoles omniscientes, infaillibles, avec lesquelles nous passons plusieurs heures par jour 7. Le « veau de silicium » qui prendrait la place du veau d’or avance à peine masqué, porté par des foules d’adeptes anonymes, insensibles aux rares voix de Cassandre qui s’élèvent. Mais une juste intelligence de l’IA permet là encore d’éviter toute méprise : les extensions tentaculaires du champ de l’IA portent en germe leurs propres limites.
Bien évidemment, les développements de l’IA qui s’annoncent auront des conséquences significatives sur notre monde, en particulier l’économie, le marché du travail, l’éducation, la santé, etc. ; ils induiront ce que les spécialistes appellent pudiquement des « coûts d’ajustements ». Il y a plus d’un siècle, les tracteurs ont rapidement rendu « inutiles économiquement » des millions de travailleurs agricoles ou petits propriétaires, alimentant les villes en nouveaux ouvriers ou immigrants. Un phénomène similaire et massif de pertes d’emplois ou de changement de contenu des emplois est annoncé, notamment via les applications de l’IA générative 8. « L’IA devrait assister et non remplacer le jugement humain, tout comme elle ne devrait jamais dégrader la créativité ou réduire les travailleurs à de simples rouages de la machine 9. »
Dans le même temps, des inquiétudes pour le respect des libertés individuelles se font jour, du fait des capacités de contrôle accrues des outils basés sur l’IA : reconnaissance faciale, croisement d’informations, stockage des données, etc. Dans le domaine de l’éducation, l’usage intensif de logiciels conversationnels et l’exposition aux réseaux sociaux semblent induire des effets délétères sur l’inventivité, comme le notent Jean-David Fermanian et Isabelle Rak. On y remarque également que les modalités de développement actuels d’IA contiennent en germe leurs propres limites : volumes de données d’apprentissage bientôt insuffisantes, capacités informatiques et consommation énergétique exponentiellement croissantes, contraintes physiques à la miniaturisation des micro-processeurs, etc 10.
En parallèle, il apparaît que les productions des IA sont susceptibles de souffrir de « biais ». En effet, par construction, ces dernières peuvent entretenir voire amplifier des états de fait constatés statistiquement mais qui peuvent être considérés par certains comme inadéquats ou discriminants (en défaveur de minorités en particulier). Cette menace a stimulé des débats autour de « l’équité algorithmique », domaine de recherche récent qui a pris une grande importance. Ses thèmes ont largement débordé la sphère académique pour se retrouver sur la place publique et concernent désormais le législateur (voir le règlement européen sur l’IA de 2024), bien que définir un algorithme équitable (« fair ») demeure un sujet de débats encore non tranchés entre spécialistes 11.
La machine et l’humain
Malgré leur réalisme et leurs facultés à imiter des capacités humaines, les IA restent bien évidemment des machines. La fascination envers les performances des IA provient d’un oubli de cette évidence. Nous avons choisi de traduire pour ce numéro un article ancien du futur Benoît XVI : même si sa rédaction remonte à une époque où robots et IA conversationnels appartenaient au domaine de la science-fiction, il s’avère particulièrement adapté à la réflexion actuelle. Il note en effet que l’homme dépose « dans la machine son propre esprit » ; l’IA générative, qui s’entraîne à partir des données et des connaissances accumulées par l’intelligence humaine, confirme pleinement cette analyse ; il ajoute : « ce qui n’est pas donné à la machine, c’est la faculté de prendre une nouvelle décision d’ordre moral et de limiter son action face à des circonstances nouvelles 12 ». La vertu de prudence est ainsi étrangère à la machine : la réflexion morale est donc plus que jamais nécessaire pour délimiter le champ d’action de ces nouveaux outils incroyablement perfectionnés. Il nous implore « de redonner sa place au contenu moral dans la connaissance et la pratique de la domination humaine sur la terre », c’est-à-dire de tout mettre en œuvre pour que les machines en général, et l’IA en particulier, restent à notre service et non nous asservissent.
Ne nous laissons donc pas abuser. Une machine, même dirigée par des algorithmes d’IA performants, restera un objet sans chair, sans cœur, sans âme. Les réponses d’un agent conversationnel, recueillies à la première personne, ne sont pas les dires d’un humain ni d’un oracle.
Leur apparence de véracité nous les fait prendre comme tels du fait d’un biais cognitif, comme le souligne Thomas Souverain. Pour nous prémunir de ces travers, le mieux est de remettre au centre ce qui constitue la spécificité de l’Homme dans la Création et de rappeler cette vérité incontournable : Nous serons jugés sur l’amour que nous avons donné et reçu. Cet amour s’incarne dans des relations, des sentiments, une corporalité à laquelle une machine ne sera jamais capable de se substituer. Les robots japonais qui « prennent soin » des personnes âgées à la place d’aides-soignants n’en sont qu’une caricature 13. Si nous nous déchargeons ainsi de nos responsabilités de soin et d’attention à l’égard de nos frères et sœurs en Christ, il faut s’inquiéter à juste titre, comme le souligne Noreen Herzfeld 14 d’une sorte de « déqualification spirituelle ». Nous risquons progressivement de ne plus pouvoir pratiquer les vertus de patience, d’amour et de tolérance.
Dans le film Her, le héros tombé amoureux d’une IA désire avoir des relations sexuelles avec cette dernière. Une agence propose alors les services d’escort girls, bien humaines celles-ci, afin de compléter l’IA pour « l’exercice ». L’expérience se termine misérablement, comme prévu. Et l’idylle tournera court lorsque le héros s’apercevra que son IA chérie entretient par ailleurs des centaines de relations similaires sans aucun « état d’âme ». Cette fable moderne a sa morale. L’IA ne deviendra que ce que nous en ferons. Ses réalisations, souvent impressionnantes d’efficacité et de réalisme, sont condamnées à rester des outils, des objets incapables de sentiments, de charité ou d’empathie. Il nous revient de ne pas l’oublier...
1 « Note sur les relations entre l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine », Antiqua et Nova, Dicastère pour la doctrine de la foi & Dicastère pour la culture et l’éducation (2025).
2 Penser à un robot capable d’effectuer en permanence les opérations de manutention et de gérer les stocks de paquets dans un entrepôt d’e-commerce.
3 Voir ci-dessous Jacques HENNO, « Les étapes du développement de l’Intelligence Artificielle », p. 47.
4 Voir ci-dessous Groupe de Travail Intelligence Artificielle du Centre Teilhard de Chardin, « La mécanisation de la pensée ou la triple réduction », p. 77.
5 Voir ci-dessous Laure SOLIGNAC, « Irréductible intelligence – Les leçons du Moyen Âge », p. 97.
6 Film de Spike JONZE, Annapurna Pictures (USA), 2013, avec Joaquin Phoenix
7 Voir ci-dessous Thomas SOUVERAIN, « L’IA générative, nouvelle idole ? », p. 65.
8 « Les capacités de l’IA générative sont sur le point de bouleverser considérablement le marché du travail, avec jusqu’à 30 % des emplois susceptibles d’être automatisés d’ici 2030. Des secteurs tels que l’industrie manufacturière, la finance et le service à la clientèle sont susceptibles d’être touchés. Cependant, l’automatisation ne signifie pas nécessai- rement la suppression d’emplois » (The Impact of Generative AI on the Future of Work: McKinsey Report, McKinsey, 2 août 2023).
9 Antiqua et Nova, op. cit., No 70.
10 Voir ci-dessous Jean-David FERMANIAN et Isabelle RAK, « Démystifier l’intelligence artificielle », p. 17.
11 Solon BAROCAS, Moritz HARDT, Arvind NARAYANAN, Fairness and machine learning: Limitations & opportunities. MIT Press, 2023.
12 Voir ci-dessous Cardinal Josef RATZINGER, « La technique nous protège-t-elle ? Une question éthique et sociale », p. 113.
13 https://my-jugaad.eu/au-japon-lesrobots-aidants-revolutionnent-la-vie-desseniors-en-maison-de-retraite/
14 Voir ci-dessous Noreen HERZFELD, « Conversation à propos de l’intelligence artificielle », (entretien avec Tibor Görföl), p. 35.
Revue papier
Revue numérique
| Titre | Prix HT € | TVA % | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|
| Noreen Herzfeld- Rester pleinement humain à l'heure de l'IA - Entretien avec Tibor Görföl - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Jacques Henno- Les étapes du développement de l'Intelligence Artificielle - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Editorial de Jean-David Fermanian et Isablle Rak- Mettre l'Intelligence Artificielle à sa juste place - pdf | Gratuit pour tout le monde | Télécharger | ||
| Jean-David Fermanian , Isabelle Rak - Démystifier l'Intelligence Artificielle - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Thomas Souverain - l'IA générative , nouvelle idole? - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Groupe de Travail Intelligence Artificielle du Centre Teilhard de Chardin- La mécanisation de la pensée ou la triple réduction - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Laure Solignac - Irréductible intelligence- Les leçons du Moyen-Age - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Cardinal Josef Ratzinger - La technique nous protège-t-elle ? Une question éthique et sociale - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| l'Intelligence Artificielle - pdf | 7.84€ | 2.10% | 8.00€ | Ajouter au panier |
