n°302 Autorité et pouvoir Novembre - Décembre 2025*
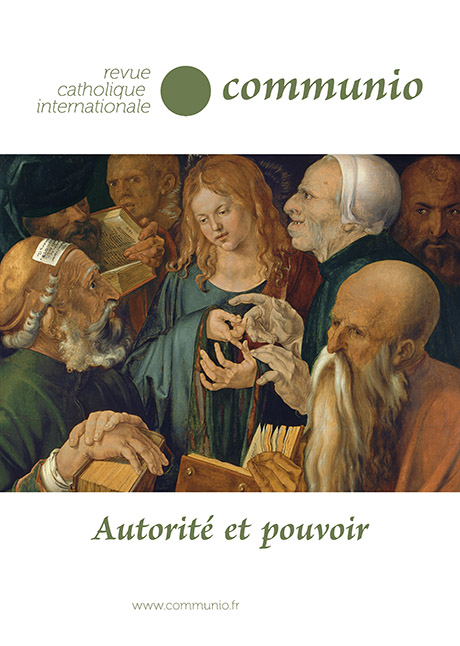
Là où l’autorité est contestée, on prétend la restaurer – souvent en vain, faute de s ’interroger sur son sens exact. Rappeler qu’elle appartient en propre à Dieu ne conduit ni à consacrer toute forme de pouvoir ni à ignorer ou absoudre les abus, même dans l’Église. Il s’agit plutôt de reconnaître que nul homme ne peut s’approprier l’autorité qui fonde et juge tout pouvoir. Le Christ lui-même la reçoit du Père, jusque dans l’impuissance de la Croix, avant de la confier aux apôtres.
Editorial de Christophe Bourgeois: Le propore de l'autorité
Jean-Marie Salamito : Pouvoir, résistance, autorité – Lectures antiques du Nouveau Testament
Dans son interprétation du Nouveau Testament, le christianisme antique part des notions romaines de potestas et d’auctoritas pour distinguer l’origine de l’autorité qui ne peut venir que de Dieu, et les moyens de son exercice dans la cité. Cette réflexion, loin de sacraliser les pouvoirs humains, leur impose une limite ; elle donne à l’Église une autorité religieuse et morale et non un pouvoir de coercition ; elle définit un sens chrétien du bien commun, qui n’exclut ni la critique ni la résistance.
Thomas Söding : Le pouvoir donné par Dieu aux hommes − L’autorité de Jésus et son ministère de salut à travers les Évangiles
L’autorité que revendique Jésus dans son enseignement, ses guérisons, son impuissance sur la Croix, et qu’attaquent avec virulence ses détracteurs, se manifeste comme un droit reçu de Dieu et une liberté d’action ordonnée à la rédemption des hommes. Elle met au premier plan la glorification du Père et l’amour du prochain. Les évangélistes analysent aussi le nécessaire transfert de l’autorité de Jésus aux disciples – sans nier les tentations d’abus auxquelles ils sont exposés.
Stefano Biancu : L’autorité comme médiation − Gaston Fessard et Giuseppe Capograssi
À quelques années de distance, les deux auteurs repensent la fonction médiatrice de l’autorité au moment où elle entre en crise. Au lien indéfectible entre autorité et recherche de la vérité, chez Capograssi, répond la vision du jésuite Gaston Fessard, pour qui la fin de l’autorité est de « disparaître en s’accomplissant » − car la finalité de l’autorité véritable est l’amour.
Thierry-Dominique Humbrecht : L’autorité, juge de soi
S’il s’agit de reconstruire les fondements de l’autorité et les modalités du pouvoir, il faut avoir le courage de passer du déni à la nomination des dérives, autant dans l’Église que dans la société. Car les abus, grands ou petits, s’accommodent d’un effacement des raisons de décider. La tentation est pour l’autorité de se couvrir, pensant ainsi sauver son honneur, alors que c’est l’inverse. Une autorité hors de ses gonds se déjuge et fausse l’obéissance qui lui est due.
Libero Gerosa : Cooperatio de tous les fidèles et exercitium du pouvoir ecclésial − Pour une authentique synodalité
Si on le confronte à l’enseignement du concile Vatican II, le nouveau code de droit canonique interprète de manière singulière l’expression sacra potestas et les modalités de son exercice : même s’il s’exerce de manière différenciée, ce pouvoir suppose la coresponsabilité de tous les fidèles dans la communion de l’Église.
Bertram Stubenrauch: Sans confusion ni séparation − Le Magistère dans la communauté ecclésiale
Bien qu’une telle affirmation ne soit pas toujours reçue comme une évidence, l’Église ne saurait exister sans une autorité doctrinale. Seule la logique sacramentelle permet d’en comprendre le fondement théologique. Le magistère garantit que l’Église vit des dons reçus, sans pour cela se substituer à la créativité des fidèles et, parmi eux, des théologiens. Une telle compréhension du magistère a aussi une portée œcuménique.
SIGNETS
Jean-Pierre Wagner : Apologétique et théologie − La leçon inaugurale d’Henri de Lubac en 1929
Dans sa conférence « Apologétique et Théologie » inaugurant son enseignement universitaire à Lyon en 1929, le P. de Lubac invite à redécouvrir le lien entre théologie et apologétique. Sa réflexion critique sur les débats qui marquent son temps annonce déjà l’œuvre à venir, tout comme son usage des auteurs qui ont marqué l’histoire de la théologie.
Jean-Luc Marion: Hommage à David Tracy (1939-2025)
David Tracy fut l’un des plus importants théologiens américains ; il enseigna principalement à the University of Chicago; membre du comité directeur de Concilium, il écrivit aussi dans l’édition francophone de Communio et soutint la fondation à Hyde Park d’un centre permettant le débat entre la culture universitaire et la pensée théologique chrétienne, dans une conversation ouverte et confiante.
Editorial de Christophe Bourgeois : Le propre de l’autorité
La contestation de l’autorité s’impose partout, à moins qu’il ne s’agisse plus simplement de sa pure et simple disparition. Il est déjà trop tard pour déplorer le déclin ou le « crépuscule » de l’autorité 1 : Hannah Arendt parlait déjà, en 1958, de l’autorité comme un passé révolu : « l’autorité a disparu (has vanished) du monde moderne 2 ». Notre situation n’a guère évolué. Un tel constat suscite en retour – et depuis longtemps – le désir d’une restauration, tout aussi légitime qu’incertain. Le couple déclin-restauration risque fort de nous abuser car nous devons moins déplorer une « crise de l’autorité », comme on l’entend partout, qu’une perte du sens de l’autorité − au sens propre : c’est d’ailleurs la définition de l’autorité qui constitue pour Hannah Arendt la question décisive. Le brouillage dont cette notion est toujours l’objet condamne par avance toutes les postures qui prétendent, à coup de slogans, défendre ou restaurer qui l’autorité de l’État, qui celle de l’école ou des magistrats... On aura d’ailleurs tôt fait d’enrôler les chrétiens dans cette croisade : l’autorité de Dieu offre un prétexte commode à tous les autoritarismes. Comme le note aussi Hannah Arendt, c’est d’ailleurs souvent une approche purement fonctionnelle de l’autorité qui en appelle au « retour » de celle-ci : c’est parce qu’on cherche comment rétablir l’obéissance des subordonnés qu’on défend l’autorité. La conséquence est pour l’auteur évidente : « nous utiliserons la violence et prétendrons avoir restauré l’autorité 3 ». Chacun peut aisément vérifier aujourd’hui la pertinence d’une telle annonce.
Il nous faut donc chercher un sens plus exact de l’autorité, dans la société civile comme dans la vie de l’Église. Car il n’est pas certain que les chrétiens eux-mêmes échappent à ces malentendus, qu’ils interprètent par avance tout acte d’autorité comme un abus de pouvoir ou qu’ils refusent d’envisager qu’on puisse abuser d’une autorité d’autant plus gravement qu’on invoque l’autorité divine dont elle découle. Le présent cahier voudrait contribuer à ce travail de clarification, en repartant de la distinction entre pouvoir et autorité. L’ironie du sort est que cette contribution risque elle-même d’être fort mal comprise : les chrétiens affirment en effet que l’autorité appartient en propre à Dieu. On croira à tort qu’il s’agit de consacrer par là toute autorité et tout pouvoir, voire de recommander un exercice autoritariste du pouvoir. Il s’agit au contraire de rappeler qu’aucun pouvoir ne peut se fonder lui-même et de réclamer que soit reconnue dans l’autorité l’instance critique de tout pouvoir, qui garantit son exercice parce qu’elle le régule – une instance qui n’entrave pas mais autorise – et donc augmente – la liberté.
Transcendance de l’autorité
Il est significatif que la réflexion chrétienne ait repris à son compte la distinction entre les notions romaines de potestas et d’auctoritas. On sait que dans la République romaine – du moins en théorie – la potestas relève du peuple, tandis que l’auctoritas relève du Sénat, qui parce qu’il n’exerce pas la potestasen contrôle la validité, en examinant sa conformité aux principes fondateurs de la cité. L’autorité permet de distinguer l’exercice du pouvoir de ce qui le fonde. Avec le sens pédagogique qu’on lui connaît, Jean-Marie Salamito montre dans la synthèse qui introduit ce cahier comment cette distinction éclaire le sens du mot grec exousia dans certains passages clefs du Nouveau Testament et, en particulier, dans le verset célèbre de l’Épître aux Romains : « Il n’y a pas de pouvoir sinon venant de Dieu » (Romains 13, 1). Cette relation à Dieu ne vient pas sacraliser indûment les pouvoirs ; elle rappelle au contraire que l’autorité divine les limite et les régule. Elle suppose donc une « dissymétrie » entre les « choses de Dieu » et les « choses de César », sur laquelle les Pères fondent leur compréhension du pouvoir politique mais aussi du rôle des chrétiens dans la cité : leur loyalisme n’exclut ni l’examen critique ni la résistance. Cette distinction entre auctoritas et potestas permet aussi de penser la relation entre l’Église, qui revendique une autorité morale et non un pouvoir coercitif, et les pouvoirs civils 4.
Dans Tout pouvoir vient de Dieu 5, Émilie Tardivel a rappelé que ce verset de l’Épître aux Romains déplace radicalement la perspective par rapport à la manière dont la République romaine comprend la différence entre auctoritas et potestas. Si l’auctoritas romaine renvoie à un fondement qui transcende l’exercice du pouvoir, cette transcendance reste interne à l’ordre politique. Au contraire, si selon l’Épître aux Romains le pouvoir « vient de Dieu », c’est que l’autorité « appartient à l’ordre de la transcendance divine », là où « la potestas appartient à l’ordre de l’immanence humaine 6 », à laquelle l’autorité de Dieu est justement irréductible. Ce verset substitue à l’indistinction des ordres dans l’interprétation du couple auctoritaspotestas la « distinction des ordres » ; l’autorité de Dieu est par là inséparable de sa charité.
Comme le démontre aussi Émilie Tardivel, cette distinction oblige à remettre en question sur certains points la manière dont Hannah Arendt reconstitue la généalogie de l’idée d’autorité en Occident, alors même qu’elle se fonde elle aussi sur la distinction romaine entre potestas et auctoritas. L’autorité renvoie selon cette dernière au « caractère sacré de la fondation », inséparable à Rome de la tradition et de la religio, qui re-lie aux pères fondateurs de la cité. Or « le caractère sacré de la fondation tient seulement à la fondation elle-même7 » : cette sacralité n’a aucune origine divine, elle ne suppose aucune « distinction des ordres ». On peut donc contester la thèse d’Hannah Arendt, lorsqu’elle affirme que « la fondation de la cité de Rome fut répétée dans la fondation de l’Église catholique 8 », notamment à travers la revendication par l’Église de l’auctoritas dévolue à l’antique Sénat et la réinterprétation chrétienne de la triade autorité – tradition – religion. Une telle vue ne prend pas suffisamment au sérieux le fait que l’autorité au sens plein, pour les Pères, appartient en propre à Dieu et que nul homme ou nulle institution ne peut donc se l’approprier. De plus, là où pour Hannah Arendt l’autorité rattache la vie politique à la mémoire d’une fondation passée, l’autorité divine inscrit l’action chrétienne dans une autre logique temporelle, en situant notre histoire par rapport à son origine « protologique » et à son « avenir eschatologique ». Par là, elle « temporalise autrement la cité, parce qu’elle ne la temporalise pas à partir d’elle-même9 ».
Il ne s’agit pas seulement d’un débat historique entre deux manières de reconstruire la généalogie de l’autorité en Occident. En affirmant que l’Église « répète » le modèle de la République romaine, Hannah Arendt laisse penser que l’affirmation chrétienne d’une transcendance divine de l’autorité autorise, au sens fort, la naissance d’un modèle politique de régime autoritaire (qu’elle distingue soigneusement de la tyrannie et du totalitarisme). Or la réinterprétation chrétienne de la distinction entre autorité et pouvoir ne se contente pas de distinguer le principe du pouvoir de son exercice : la transcendance de l’autorité divine interdit radicalement au pouvoir de se fonder lui-même et le rend, selon la formule décisive d’Émilie Tardivel, « véritablement inappropriable en son fondement 10 » ; c’est par là qu’elle garantit paradoxalement l’autonomie et la fécondité, dans son ordre, d’un pouvoir qui ne se referme pas sur lui-même, et c’est aussi par là qu’elle oriente positivement l’action des chrétiens dans la cité non vers la défense de leurs intérêts ou l’instauration d’une théocratie mais vers une contribution au bien commun selon l’ordre de la charité divine. Le rapport eschatologique des chrétiens au temps politique confirme l’autonomie de la cité tout en l’ordonnant à la dynamique du salut, pour que l’ordre de la charité puisse tout transformer.
L’autorité du Christ permet de saisir ce paradoxe à sa racine et d’en mesurer la nouveauté. Alors même que la langue grecque n’a à sa disposition qu’un seul mot, exousia, et ne possède pas l’équivalent du couple potestas-auctoritas, la manière dont les évangélistes interprètent l’exousia du Christ montre comment celui-ci peut exercer en toute justice et liberté son pouvoir précisément parce qu’il ne peut s’approprier ce qui est don gratuit du Père. Lorsque Jésus prêche, sa parole s’impose d’elle-même – ou plutôt ne s’impose pas mais suscite chez les disciples la reconnaissance inconditionnelle de sa légitimité : « sa parole était pleine d’autorité » traduit-on (Luc 4, 31). On lit en grec en tê exousia (que la Vulgate traduit par in potestate) : la parole du Christ porte en effet en elle un pouvoir, au sens d’une capacité d’agir sans contrainte pour transformer ses auditeurs, comme le montre Thomas Söding11. L’extension d’un tel pouvoir d’action est inouïe. La tradition johannique le montre dans la prière sacerdotale, lorsque Jésus remercie Dieu de lui avoir « donné pouvoir sur toute chair » (Jean 17, 2) ; la tradition synoptique y insiste aussi, en rappelant combien la revendication par le Christ de cette exousia divine pose problème à ses détracteurs. Or ce n’est pas un pouvoir ou une autorité que le Christ se donne à lui-même : ils sont indissociables de son obéissance au Père tout-puissant – une obéissance dans l’amour qui ne vient pas limiter mais fonder et dilater la liberté du Fils. Le Christ accomplit ainsi en sa personne ce que la réflexion politique sur l’autorité issue de l’Antiquité voulait concevoir : une obéissance en toute liberté. Thomas Söding montre également comment la tradition synoptique interprète l’autorité singulière du Christ à travers la tension entre sa puissance et son impuissance, en particulier lorsqu’il apparaît sur la Croix comme le juste souffrant, pour accomplir par cette impuissance même son oeuvre de salut. La nouveauté décisive introduite par le Christ tient donc à l’unité indéfectible entre autorité et mission dans sa personne – mission au sens où il se reçoit tout entier du Père, mission aussi au sens où il est envoyé pour le salut de tous. Thomas Söding choisit pour décrire cette dynamique le terme de « pro-existence » : le pouvoir et l’autorité de Jésus se déploient dans sa chair comme être-pour-les-autres.
Désappropriation
Découlant de la communion d’amour du Père et du Fils, l’exousia du Christ rend ainsi la liberté humaine à elle-même. Mais la lumière divine qui en émane peut-elle éclairer les situations plus obscures et plus incertaines dans lesquelles s’exerce non pas l’autorité de Dieu ou du Christ, ni même l’autorité d’un principe constitutif de l’ordre politique – comme la loi – mais l’autorité d’un homme ordinaire et faillible, qui s’adresse à d’autres hommes qui ne veulent pas ou ne savent pas reconnaître cette autorité ? Il peut même sembler plus facile de penser la transcendance de l’autorité divine que de penser l’autorité d’une fonction ou d’un État. Les développements précédents permettent peut-être de reformuler les termes du problème : il s’agit que puisse se traduire concrètement dans l’existence d’un homme ou la vie d’une institution ce caractère inappropriable du fondement du pouvoir, qui rend possible la liberté. Loin de sacraliser l’autorité d’un homme ou d’une institution, la transcendance absolue de l’autorité divine la dés-absolutise autant que le pouvoir qui en découle.
Il n’est donc d’autre manière pour notre existence de marquer ce caractère inappropriable qu’une lente et souvent douloureuse désappropriation. Giuseppe Capograssi écrit au sortir de la Première Guerre mondiale, dans son premier essai philosophique, que « l’autorité est un bien inestimable et fragile que les hommes croient avoir uni inséparablement à leur nature ; ils ne savent pas qu’elle est le résultat difficile et épuisant d’une vie entière dévouée à la vérité, et qu’elle se perd et s’efface sans espoir si la vérité s’obscurcit dans l’âme12 ». Là où nous cherchons trop souvent à nous arroger l’autorité comme un bien propre, il nous faut accepter que sa précarité est la marque de sa vraie valeur, puisque nous ne pouvons l’exercer que de manière dérivée.Dans la présentation synthétique qu’il propose de l’oeuvre de Capograssi, Stefano Biancu insiste sur le lien indéfectible entre autorité et recherche de la vérité, qui permet seul que l’autorité retrouve la fonction médiatrice qu’exige à la fois notre recherche de la vérité et notre recherche d’un ordre juste. L’autorité est ainsi pensée en fonction du déploiement dans le temps de la personnalité, de l’humanisation de l’homme 13. Stefano Biancu propose également de comparer le travail de Capograssi à celui de Gaston Fessard :on sait que le jésuite rédige durant l’occupation allemande Autorité et bien commun, parce que la nécessité de lutter contre le nazisme et la collaboration exigent ce travail philosophique. Ce cahier doit beaucoup à sa définition de l’autorité comme « vouloir de sa propre fin »,car « la fin de l’autorité » est « de disparaître en s’accomplissant 14 ». La réalisation du Bien commun qu’elle vise suppose justement que l’autorité ne soit dans la constitution de la société que médiatrice et qu’elle ne puisse donc être absolutisée.
Ce n’est pas parce que l’Église revendique par rapport aux pouvoirs civils une autorité de type prophétique qu’elle échappe dans son devenir historique à ces difficultés – tout au contraire. La tension entre auctoritas et potestas est d’autant plus exposée aux malentendus et aux abus que l’on parle et agit – et donc que l’on exerce un pouvoir – au nom de Dieu. L’article de Thomas Söding le rappelle : si les évangélistes montrent la nécessité d’un « transfert d’autorité 15 » de Jésus aux Douze et à leurs successeurs pour que l’exousia du Fils continue de s’exercer concrètement aujourd’hui pour tous les chrétiens, ils envisagent d’emblée les tentations auxquelles sont exposés ceux qui reçoivent la mission de participer à cette autorité du Fils et qui ne peut être vécue que dans l’obéissance du Fils. Elle exige donc une plus radicale désappropriation – car c’est ainsi que l’Esprit du Crucifié nous transforme.
Sur ce point, on évitera d’interpréter la vie de l’Église selon un modèle purement politique ou sociologique. La potestas en elle est d’abord rapportée à la célébration des sacrements dont elle découle : contrairement à ce que l’on entend çà et là, le lien intrinsèque entre les fonctions de gouvernement et le sacerdoce ministériel n’a donc pas pour but d’asseoir et de perpétuer une domination mais à rebours de rendre tout pouvoir dépendant du Serviteur crucifié dont la grâce se répand par l’actualisation du mystère pascal dans la liturgie. De même, l’auctoritas d’un évêque ou d’un pape suppose le lien aux auctoritates qui le précèdent, tout comme la conformité de ses actes et de ses paroles à la regula fidei, que le sensus théologique des fidèles peut percevoir et vérifier. La permanence d’un principe d’autorité dans l’Église, qui passe en Occident pour un vestige incompréhensible du passé, garantit paradoxalement l’égalité de tous les fidèles dans la communion.
On n’évitera pas, pour examiner concrètement ces questions dans la structure et la vie de l’Église, une certaine technicité. Les débats actuels sur la synodalité, auxquels deux articles de ce numéro font écho, y obligent. Bertram Stubenrauch revient ainsi sur le sens du magistère ecclésiastique dont l’autorité a parfois été remise en cause par le chemin synodal allemand. Or l’autorité du magistère atteste que « l’Église ne se doit pas à elle-même et ne s’enseigne pas elle-même ». Elle garantit aussi la créativité des baptisés qui s’approprient et actualisent personnellement les dons reçus. Il reste à bien comprendre le sens et les conditions de son exercice : Bertram Stubenrauch défend ainsi l’idée d’une forme de « séparation des pouvoirs » ou à tout le moins un partage des tâches entre recherche théologique personnelle et discours magistériel. Ni les évêques ni les papes ne sont là pour « élever leur propre point de vue théologique [...] au rang de doctrine incontestable et fondamentale pour tous 16 ». À l’inverse, ceux qui, sous prétexte de démocratiser l’Église, voudraient abandonner à une instance participative, détachée du sacrement de l’ordre, le pouvoir doctrinal risquent fort de réduire l’intelligence de la foi à un pur rapport de forces entre écoles théologiques. Dans le sillage d’Eugenio Correco 17, Libero Gerosa examine de son côté l’usage par le nouveau code de droit canonique de ’expression sacra potestas, pour montrer comment la structure sacramentelle de l’Église peut fonder et garantir la coopératio de tous les fidèles dans l’exercice de la potestas et par là la communion de l’Église 18.
Les catholiques n’éviteront pas non plus un sérieux examen de conscience. Le frère Thierry-Dominique Humbrecht y invite avec vigueur 19. Les enquêtes passées et en cours sur les abus sexuels rappellent que ces crimes ont pu être perpétrés à la faveur des situations d’emprise et des positions d’autorité dont abusent – justement – les prédateurs : elles invitent à prendre aujourd’hui la vraie mesure des abus de pouvoir et d’autorité qui, au-delà des crimes sexuels, portent atteinte à la liberté des enfants de Dieu et défigurent la vertu d’obéissance, tout particulièrement chez ceux qui en font le voeu ou la promesse. L’auteur évite toute polémique ad personam mais il parle de situations dans lesquelles tout lecteur peut se reconnaître. Il est vain de vouloir se dérober à cette exigence de vérité, sous prétexte de sauver les apparences pour préserver l’autorité : elle en sera plus sûrement ruinée. Le sens de l’autorité exige précisément cette purification radicale. Il exige qu’on puisse dans l’Église rendre raison de l’exercice de l’autorité : là comme ailleurs, là plus qu’ailleurs, l’exigence de vérité, quel qu’en soit le prix, permet de vérifier que nul ne s’approprie l’autorité donnée.
1 Robert A. NISBET, Twilight of Authority, Oxford, Oxford University Press,1975.
2 Hannah ARENDT, «Qu’est-ce que l’autorité ? », La crise de la culture, Gallimard, [1972], Collection Folio Essais, p. 121. L’article d’abord paru dans la revue Nomos en 1958, est ensuite repris en 1961 dans Between Past and Future.
4 Jean-Marie SALAMITO, «Pouvoir, résistance, autorité − Lectures antiques du Nouveau Testament », dans ce cahier p. 17.
5 Émilie TARDIVEL, Tout pouvoir vient de Dieu, un paradoxe chrétien, 2e édition, Ad Solem, 2015, p. 63-70.
8 «Qu’est-ce que l’autorité ? », art. cité, p. 166.
9 Tout pouvoir vient de Dieu, op. cit., respectivement p. 70 et p. 74.
11 «Le pouvoir donné par Dieu aux hommes. L’autorité de Jésus et son ministère de salut à travers les Évangiles », dans ce cahier p. 35.
12 Essai sur l’État, [1918], traduit en français par Christophe Carraud, Trocy-en-Multien, Éditions de la revue Conférence, 2015, p. 175.
13 L’autorité comme médiation : Gaston Fessard et Giuseppe Capograssi, dans ce cahier p. 49.
14 Gaston FESSARD, Autorité et bien commun, édité par F. Louzeau, Ad Solem, 2015, p. 58.
15 « Le pouvoir sonné par Dieu aux hommes. L’autorité de Jésus et son ministère de salut à travers les Évangiles », op. cit., p. 35.
16 « Sans confusion ni séparation – le Magistère dans la communion ecclésiale », dans ce cahier, p. 89. Cet article offre un contrepoint stimulant à la réflexion initiée dans notre numéro intitulé Les magistères, no 255, janvier-février 2018.
17 Professeur de droit canonique et évêque de Lugano, Eugenio Corecco (1931-1995) fut membre de la redaction francophone de Communio. On pourra relire son article intitulé « Structure et articulation du pouvoir dans l’Église »,Communio, no 55, 1984.
18 « Cooperatio de tous les fidèles et exercitium du pouvoir ecclésial : pour une authentique synodalité », dans ce cahier p. 77.
Jean-Pierre Wagner : Apologétique et théologie − La leçon inaugurale d’Henri de Lubac en 1929
Dans sa conférence « Apologétique et Théologie » inaugurant son enseignement universitaire à Lyon en 1929, le P. de Lubac invite à redécouvrir le lien entre théologie et apologétique. Sa réflexion critique sur les débats qui marquent son temps annonce déjà l’œuvre à venir, tout comme son usage des auteurs qui ont marqué l’histoire de la théologie.
Jean-Luc Marion: Hommage à David Tracy (1939-2025)
David Tracy fut l’un des plus importants théologiens américains ; il enseigna principalement à the University of Chicago; membre du comité directeur de Concilium, il écrivit aussi dans l’édition francophone de Communio et soutint la fondation à Hyde Park d’un centre permettant le débat entre la culture universitaire et la pensée théologique chrétienne, dans une conversation ouverte et confiante.
Revue papier
| Prix HT €* | TVA % | Prix TTC* | Stock |
|---|---|---|---|
| 13.71€ | 2.10% | 14.00€ | 41 |
Revue numérique
| Titre | Prix HT € | TVA % | Prix TTC | Action |
|---|---|---|---|---|
| Autorité et pouvoir - pdf | 7.84€ | 2.10% | 8.00€ | Ajouter au panier |
| Editorial de Christophe Bourgeois- Le propre de l'autorité - pdf | Gratuit pour tout le monde | Télécharger | ||
| Jean-Marie Salamito- Pouvoir , résistance, autorité-Lecture antiques du Nouveau Testament - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Thomas Söding- Le pouvoir donné par Dieu aux hommes - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Stefano Biancu- L'autorité comme médiation - Gaston Fessard et Giuseppe Capograssi - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Thierry-Dominique Humbrecht- L'autorité , juge de soi - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Libero Gerosa- Cooperatio de tous les fidèles et exercitium du pouvoir ecclésial- Pour une authentique synodalité - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Bertram Stubenrauch - Sans confusion ni séparation- Le Magistère dans la communauté ecclésiale - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Jean-Pierre Wagner - Apologétique et théologie- La leçon inaugurale d'Henri de Lubac en 1929 - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
| Jean-Luc Marion - Hommage à David Tracy ( 1939-2025) - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |
